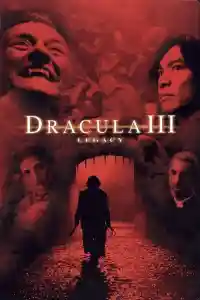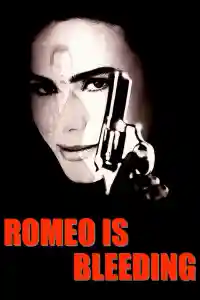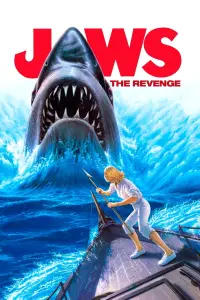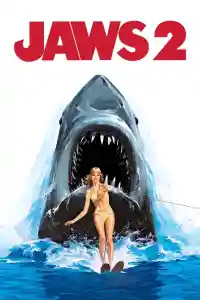Roy Scheider
- Casting
Détails
| Âge |
|
Nationalité |
|---|---|
| Filmographie | 11 films |
| Récompenses | 3 nominations et 0 victoire |
Biographie
Roy Scheider, né le 10 novembre 1932 à Orange, dans le New Jersey (États-Unis), et décédé le 10 février 2008 à Little Rock, dans l’Arkansas, est un acteur américain dont le visage buriné, le regard anxieux et la diction précise ont marqué plusieurs classiques du cinéma des années 1970 et 1980. Il n’était pas l’archétype du héros musclé ou du séducteur flamboyant, mais plutôt une incarnation du doute, de la tension intérieure, du type ordinaire placé dans des situations extraordinaires.
Qu’il joue un chef de police face à un requin géant, un danseur dévoré par la création ou un agent gouvernemental traqué, Roy Scheider apporte toujours un mélange de retenue et d’urgence. Un acteur à l’élégance nerveuse, dont la carrière a parfaitement épousé le virage du Nouvel Hollywood, avec ses anti-héros plus humains que mythologiques.
Le théâtre et la télévision comme tremplins
Avant d’atteindre le grand écran, Roy Scheider passe par le théâtre, puis par quelques séries et téléfilms dans les années 1960. Il développe un style sobre, tout en contrôle, influencé par sa formation au sein de l’Actors Studio et son passé d’athlète (il a longtemps pratiqué la boxe et le baseball).
Il débute au cinéma dans des seconds rôles discrets, jusqu’à ce que les années 1970 l’installent parmi les acteurs de référence d’un cinéma américain plus réaliste, plus inquiet, plus politique.
French Connection et la percée hollywoodienne
Le premier grand coup arrive en 1971, avec The French Connection de William Friedkin, où Roy Scheider incarne l’inspecteur Buddy Russo, partenaire du légendaire Popeye Doyle interprété par Gene Hackman. Un rôle secondaire, certes, mais parfaitement tenu, qui lui vaut une nomination à l’Oscar du meilleur second rôle.
Le film, célèbre pour sa tension brute et ses poursuites en voiture nerveuses, impose Roy Scheider comme un acteur solide, capable de porter la tension d’un polar urbain sans effet de manche. Il devient dès lors un nom que les réalisateurs sérieux commencent à regarder de près.
Les Dents de la mer : un héros malgré lui
En 1975, Steven Spielberg, encore jeune réalisateur en pleine ascension, lui confie le rôle du chef Martin Brody dans Jaws (Les Dents de la mer). C’est le rôle d’une vie.
Face à un requin tueur (et à des conditions de tournage épiques), Roy Scheider incarne un homme banal, dépassé par la situation, mais qui s’accroche, combat ses peurs et finit par affronter l’horreur. Pas de discours héroïque, pas de muscles saillants, juste un flic inquiet, terrien, presque maladroit, mais profondément humain.
Le film est un immense succès planétaire, fondateur du blockbuster moderne, et Roy Scheider devient, presque malgré lui, une star. Il reprendra le rôle de Brody dans Jaws 2 (1978), avec moins de ferveur, et refusera de participer au troisième opus — une décision qui en dit long sur son attachement à l’intégrité du personnage.
All That Jazz : une performance déchirante
En 1979, Roy Scheider surprend tout le monde dans All That Jazz de Bob Fosse, un semi-biopic halluciné sur la vie d’un metteur en scène de comédies musicales (inspiré de Fosse lui-même). Il y joue Joe Gideon, artiste brillant et autodestructeur, qui jongle entre création, drogues, femmes et crises cardiaques.
C’est un rôle totalement à contre-courant de son image. Et il y est exceptionnel. Il danse, il fume, il s’effondre, il charme, il meurt. Il montre qu’il n’est pas seulement un acteur de tension, mais aussi un acteur de déchirure.
Le film est un chef-d’œuvre baroque et mélancolique, et la performance de Roy Scheider lui vaut une nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Le rôle reste à ce jour l’un des sommets de sa carrière.
Une carrière marquée par la diversité et les choix audacieux
Tout au long des années 1980, Roy Scheider continue à tourner, en alternant thrillers politiques, films de science-fiction et drames psychologiques. On le retrouve dans Blue Thunder (1983), 2010: The Year We Make Contact (1984), ou encore 52 Pick-Up (1986). Son jeu reste constant : sobre, crédible, tendu, avec cette capacité à incarner la normalité face au chaos.
Mais avec la fin des années 1980, les rôles majeurs se font plus rares. Il accepte des projets plus mineurs, mais continue à travailler sans relâche, parfois à la télévision (comme dans seaQuest DSV, une série de science-fiction produite par Spielberg), parfois dans des productions indépendantes, toujours avec la même rigueur.
Une élégance discrète, un acteur sans vanité
Roy Scheider n’a jamais été un acteur flamboyant. Il n’a jamais cherché à devenir une icône. Et c’est peut-être ce qui fait que ses personnages paraissent si vrais. Il savait écouter une scène, observer un partenaire, habiter un silence. Il n’occupait pas l’espace, il le tendait.
Il a incarné des flics fatigués, des artistes en crise, des hommes ordinaires confrontés à l’absurde. Et à chaque fois, il trouvait le ton juste, sans forcer. Pas de cabotinage. Juste un sens aigu de la gravité, du moment, de la tension.
Roy Scheider, l’anti-héros devenu indispensable
Avec le recul, Roy Scheider apparaît comme l’un des visages les plus marquants d’un certain cinéma américain des années 70 et 80, celui où les héros étaient faillibles, humains, ambigus. Il ne portait pas de cape, ne lançait pas de punchlines, mais il avait ce regard inquiet, ce sourire en coin, cette intensité muette qui racontaient mille choses sans qu’il ait à hausser le ton.
Il est mort en 2008, des suites d’un cancer, à 75 ans. Une disparition discrète, à l’image de sa carrière. Mais son empreinte reste intacte. Un peu comme Brody sur sa barque, à la fin de Jaws : pas le plus fort, mais celui qui reste. Parce qu’il tient bon. Parce qu’il est là. Parce qu’il est vrai.